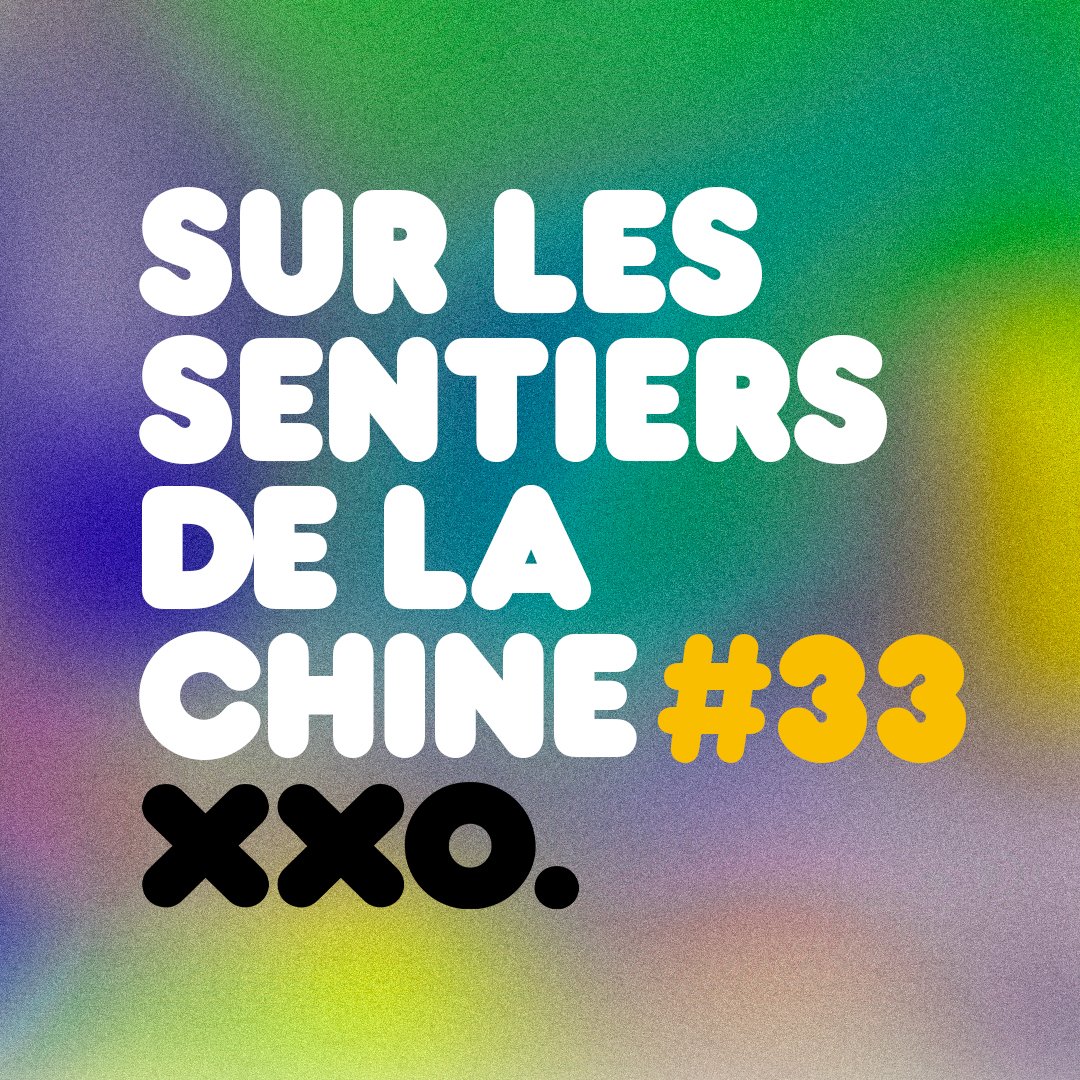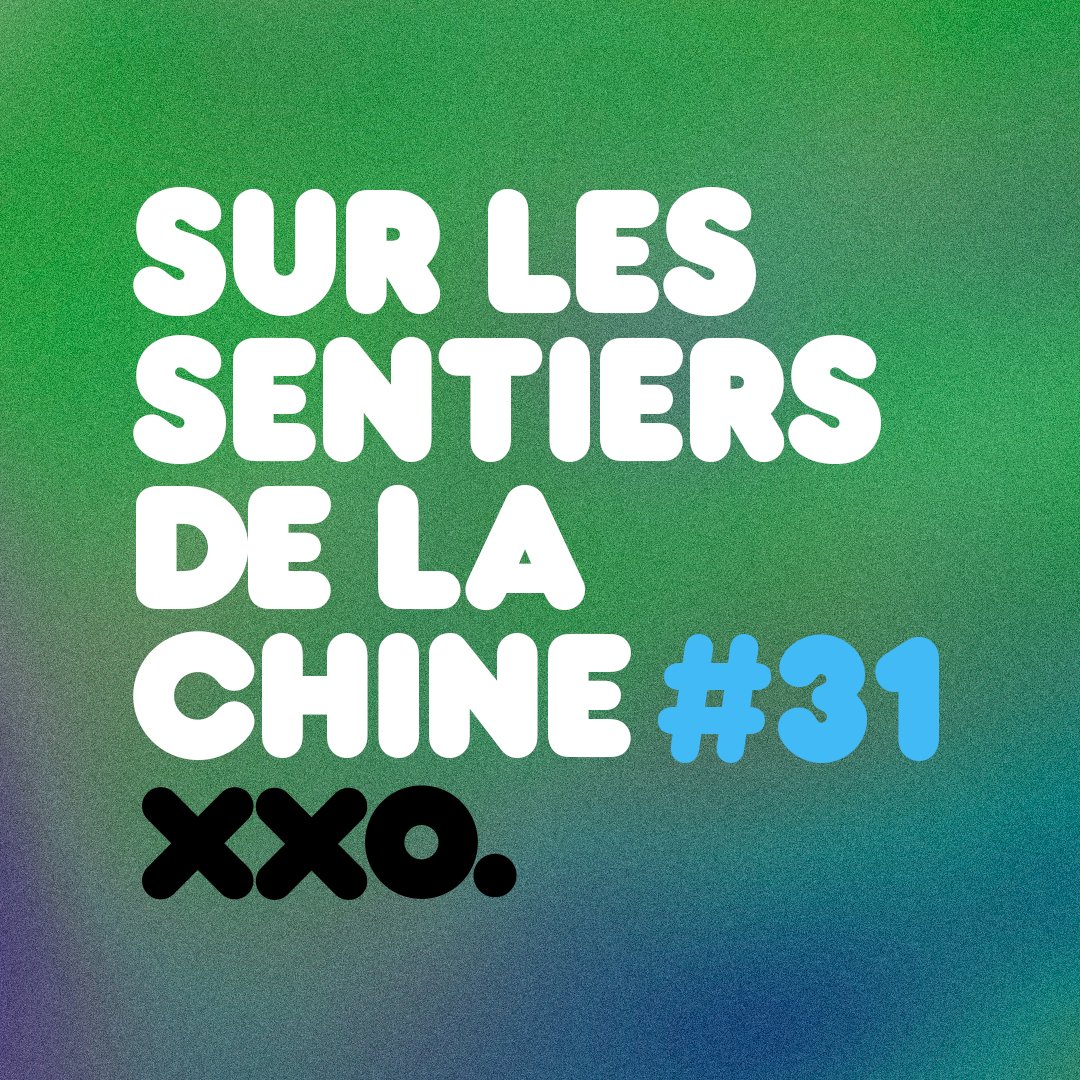ROBERT MALLET-STEVENS & L’UNION DES ARTISTES MODERNES
un article de Laurent Courau
Première partie
 Portrait de Robert Mallet-Stevens, vers 1924. © D.R. Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens
Portrait de Robert Mallet-Stevens, vers 1924. © D.R. Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, fonds Mallet-Stevens
Aristocratique et raffinée, la silhouette élancée de Robert Mallet-Stevens domine les débats dans la salle enfumée du vieux bistrot du quatorzième arrondissement parisien, où la légende veut que se soit tenue la première réunion de l’Union des artistes modernes, au mois de mai 1929.
Autour de lui, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Charles Édouard Jeanneret dit Le Corbusier et Pierre Jeanneret, tous architectes et décorateurs, ici réunis par le refus de l’éminent Salon des artistes décorateurs, où ils exposaient jusqu’alors, de leur accorder un espace jugé adapté et suffisant. En réaction, le groupe de jeunes gens modernes choisit de se rebeller par la création d’un nouvelle branche dissidente : l’Union des artistes modernes (UAM). Un mouvement dont l’objet premier sera d’organiser des événements d’un genre inédit, qui permettront aux arts dits majeurs et mineurs de coexister sans hiérarchie entre les disciplines.
Une ligne de fracture certes traditionnelle entre les générations, qui n’en souligne pas moins les dynamiques novatrices qui auront animé toute la vie et l’oeuvre de Robert-Mallet Stevens, avec la contemporanéité pour règle première. « Être de son temps », envers et contre tout, jusqu’à souffrir durant de longues décennies d’une postérité malmenée. Décédé quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et par conséquent absent de la reconstruction du pays, Mallet-Stevens sera longtemps éclipsé par d’autres figures de l’architecture moderne telles que Le Corbusier. Il faudra attendre le milieu des années 2000 pour que le Centre Pompidou se décide à lui consacrer une exposition d’envergure, avec le soutien important d’une poignée de passionnés.
Ce que souligne Xavier Gellier, à l’occasion d’un entretien réalisé dans les locaux de XXO : « J'avais l’envie de produire une série d'articles sur les grands créateurs du XXᵉ siècle. Pour démarrer, mon choix s’est naturellement porté sur Robert Mallet-Stevens, en hommage à mon maître à penser : Michel Souillac. Un grand marchand et un antiquaire atypique, qui a consacré une part importante de sa vie professionnelle à documenter et à faire reconnaître l’oeuvre de l’architecte et décorateur moderniste, restée injustement méconnue du grand public. Michel avait ainsi contribué à la première grande rétrospective de Mallet-Stevens, qui s’est tenue à Beaubourg en 2005. Le fruit d’un long travail de collectionneur, mais aussi de documentation et d’archivage, qui a participé à réhabiliter ce grand moderniste. »
Paris, dans le tourbillon des Années folles
Retour vers le printemps 1929. La capitale se remet avec difficultés d'un hiver glacial. Mais Paris n’en demeure pas moins une fête, selon le titre d’un roman de l’écrivain américain Ernest Hemingway. Des artistes venus des quatre coins de l’Europe, sinon du monde entier, continuent de converger vers la ville lumière, toujours considérée comme un symbole de liberté et de modernité. Alors qu’à la même période, Joseph Staline achève de prendre le pouvoir en URSS, et que Benito Mussolini se prépare à marcher sur Rome à la tête du Parti national fasciste qu’il a récemment fondé.
Parmi ces nouveaux Parisiens, le Lituanien Soutine, l'Italien Modigliani et le Russe Chagall, ou encore le Japonais Foujita, l’Allemand Max Ernst, l’Américain Man Ray et sa muse Kiki de Montparnasse qui font du carrefour Vavin, au croisement du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse, un véritable « centre du monde » des avant-gardes artistiques. De nouveaux clubs, tels que Le Bœuf sur le toit, rue du Colisée, et Le Grand Duc à Pigalle, se créent pour accueillir les jazzmen noirs qui fuient à leur tour la prohibition et la recrudescence du Ku Klux Klan aux États-Unis.
Francis Scott Fitzgerald, Henry Miller, Ernest Hemingway et leurs camarades écrivains de la « génération perdue » passent leurs nuits à refaire le monde sur les banquettes du Sélect, de la Coupole et de la Closerie des Lilas. Salvador Dali s’initie au surréalisme auprès d’André Breton, pendant que Josephine Baker défraie la chronique avec sa Revue nègre sur les planches du théâtre des Champs-Élysées. Paris vibre au rythme des orchestres venus d’outre-Atlantique. Et bientôt, de nouvelles danses, comme le Charleston ou le Black Bottom, déchaînent les noctambules.
Mais les Années folles ne sont pas qu’une période de bouillonnement artistique. Le progrès technologique participe lui aussi de cette effervescence. Durant cette période, la ville se métamorphose au gré de la construction de nouveaux bâtiments dans un style Art déco qui fait la part belle aux épures précieuses et au béton. Grâce à l'électricité, de nombreuses innovations voient le jour, dont l'aspirateur, la machine à laver et le réfrigérateur. Les automobiles commencent à envahir les rues. On commence à s’équiper de postes de radio dans les cafés et jusque dans certains foyers fortunés.
L’époque s’avère d’une modernité incomparable, ce qui ne va pas sans entraîner quelques bouleversements et polémiques dans la société française. Les moeurs évoluent. Les organisations féministes multiplient les actions pour réclamer l'égalité des droits. Depuis son atelier de la rue Cambon, proche du Palais-Royal, la créatrice de mode Coco Chanel encourage ainsi les Parisiennes à adopter une coupe de cheveux à la mode « garçonne ». Elle participe à débarrasser les femmes de leurs corsets contraignants, jusqu’à raccourcir leurs jupes au-dessus du genou.
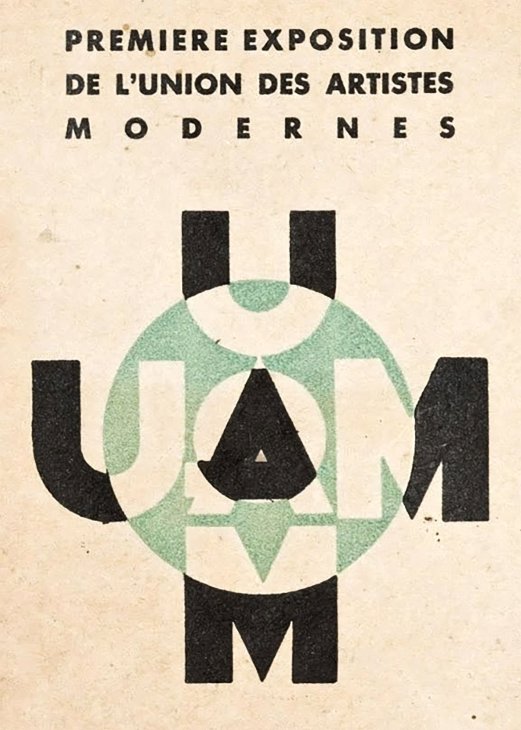
Une série de révolutions conceptuelles et esthétiques
De fait, la fondation de l’Union des artistes modernes (UAM) par le groupe d’architectes et de décorateurs réunis autour de Robert Mallet-Stevens s’inscrit dans le sillage d’une série de révolutions conceptuelles et esthétiques sans précédent dans l’histoire des sociétés occidentales. Après les scandales causés par les impressionnistes en France durant la seconde moitié du XIXe siècle, c’est au tour de Marinetti et des Futuristes italiens de rejeter avec violence le « culte archéologique du passé », pour exalter l’amour de la vitesse automobile, de la civilisation urbaine et des machines.
À la même époque en Russie, une nouvelle génération d’artistes s’érige contre ce qu’elle qualifie d’art bourgeois, en dénonçant notamment les formes artistiques importées d’Europe de l’Ouest, alors appréciées par les élites moscovites. Ce mouvement revendique un art d’avant-garde basé sur le fonctionnalisme et la supériorité absolue de la forme, avec pour objectif l’éclosion d’une civilisation nouvelle qui réunira tous les peuples sous une seule bannière. Inspiré par le bolchévisme, le constructivisme devient l'art « officiel » de la révolution russe de février 1917.
En octobre 1917 paraît le premier numéro de la revue De Stijl aux Pays-Bas. Son fondateur Theo van Doesburg y fait la promotion des idées de Piet Mondrian, l'un des pionniers de l'art abstrait, sur la représentation de l'essence du réel et l’harmonie universelle, sous la double influence de son père pasteur calviniste et de la pensée théosophique de l’occultiste Helena Blavatsky. Les artistes et les designers néerlandais réunis autour de De Stijl revendiquent ainsi l’abstraction comme langage universel pour l’ère moderne, entre mystique, hygiénisme et formules mathématiques.
En Allemagne, l’architecte, designer et urbaniste allemand Walter Gropius fusionne l’école des Arts décoratifs et l’Académie des beaux-arts de la ville de Weimar pour donner naissance à une nouvelle école qu’il baptise Staatliches Bauhaus au mois d’avril 1919. Le manifeste qu’il écrit à cette occasion stipule « qu’il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan. Ensemble, ils se doivent de concevoir et de créer une nouvelle construction de l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme : architecture, art plastique et peinture ».
À travers toute l’Europe, on retrouve ce même désir de rompre brutalement avec le passé. Le ton est violent, l’heure à la radicalité. Une génération entière d’artistes est invitée à sortir des ateliers pour participer à l’élaboration d’une société nouvelle. Afin de réinventer le monde, dans un sursaut d’énergie spontanée, directement lié aux traumatismes encore bien présents de la Première Guerre mondiale.

Enfance et formation de Robert Mallet-Stevens
Robert Mallet-Stevens naît le 24 mars 1886 au coeur des beaux quartiers parisiens, au numéro 60 du boulevard Malesherbes. Une artère alors récente, issue de la politique de grands travaux que le baron Haussmann vient de mener sous le Second Empire, entre les années 1853 et 1870. Son père, Maurice Mallet, est collectionneur d’art et expert en tableaux à l'Hôtel des ventes de Drouot. Sa mère est la fille du critique d’art Arthur Stevens, lui-même frère du peintre belge Alfred Stevens, proche des impressionnistes et ami d’Édouard Manet, de Berthe Morisot et d’Alexandre Dumas (fils).
Sa tante Suzanne Stevens est l’épouse d’Adolphe Stoclet, financier bruxellois et grand amateur d'art, héritier d’une importante famille de banquiers belges. Stoclet est le commanditaire du palais qui porte son nom à Woluwe-Saint-Pierre, l’une des communes résidentielles les plus huppées de Belgique. Conçu par l’architecte autrichien Josef Hoffmann, qui reçoit carte blanche et bénéficie d’un budget illimité, le Palais Stoclet s’avère rien moins que révolutionnaire. La sobriété géométrique de ses lignes tranche avec le style ornemental de l’Art nouveau et préfigure déjà le « style Art déco ».
Pour sa construction, qui débute en 1903 et s’achèvera en 1911, Hoffmann s’entoure des artisans de la Wiener Werkstätte, un atelier viennois dont la production influence la plupart des avant-gardes de cette période. Sa décoration est signée par le peintre autrichien Gustav Klimt et l’artiste belge Fernand Khnopff. Le bâtiment est pensé jusque dans ses moindres détails, depuis ses luminaires jusqu’à ses boutons de portes et aux bacs à fleurs de son jardin. Une forme de collaboration entre des artistes et des artisans qui illustre le concept aussi novateur que fondamental, d’« œuvre d’art totale ».
Nul doute que la fréquentation du chantier du Palais Stoclet, entamée alors qu’il n’a pas dix-huit ans, exercera une forte influence sur les choix esthétiques du futur fondateur de l’Union des artistes modernes.
Robert Mallet-Stevens choisit d’étudier à l’École spéciale d’architecture où il entre en 1903. Un choix en rien d’anodin, puisqu’il s’agit de l’unique école privée d’architecture en France, réservée à des étudiants qui bénéficient de moyens financiers importants. Mais aussi d’un établissement dont la pédagogie est basée sur la pensée rationaliste de Viollet-le-Duc, contre l’académisme des Beaux-arts. Mallet-Stevens y reçoit le prix du deuxième diplôme en 1906 pour un projet d’« hôtel privé », qui ne va pas sans rappeler son environnement familial et dont la rédaction commence par « Monsieur et Madame N… ont une jolie fortune et mènent une vie de luxueuse aisance ».
« Être de son temps » est déjà, pour lui, l’obligation essentielle de l’architecte. Fraîchement diplômé, il s’illustre par une série d’articles, écrits en collaboration avec Jacques Rœderer, pour la revue britannique The Architectural Review en 1907. Puis persiste et signe dans les revues belges Le Home et Tekhné, ainsi que dans le périodique français L’Illustration (1843-1944), journal de la bourgeoisie républicaine. Mais aussi titre novateur d’un point de vue éditorial et technologique, notamment par la place qui y est accordée aux images et l'utilisation de procédés photomécaniques, avec pour devise d’être un « journal universel ».

Engagé volontaire en 1915, Mallet-Stevens occupe un poste d’observateur aérien dans l’aviation. À ce sujet, il est intéressant de noter que l’aéronautique militaire française reste encore une nouveauté. La France étant le premier pays à s’être équipé d'avions de combat en 1909 et le jeune architecte se trouve encore une fois à la pointe de la modernité. Mais cette affectation témoigne aussi de son rang social, l’accession à ces régiments étant réservée aux classes supérieures de la société. Loin de la boue des tranchées où l’on estime que près de 1 400 000 soldats français perdront la vie, soit 27 % de la tranche d’âge des 18-27 ans à laquelle il appartient.
Seconde partie, à suivre : Le couturier Paul Poiret et le Salon d’Automne, la villa Noailles, Robert Mallet-Stevens et le 7ème art, les arts décoratifs et industriels modernes, l’Union des artistes modernes (UAM), la villa Cavrois.
Pour être informé régulièrement de nos actualités, des nouveautés de notre catalogue et des ventes de mobilier que nous organisons, inscrivez‑vous à nos newsletters, notre instagram ou notre facebook.
Découvrez aussi…
13/09/2023
20/06/2025
20/05/2025